Le choix de Kat pour des actualités toniques, positives, colorées, décalées, légères, pleines d'espoir, d'humour et d'amour de la vie. Clic sur le titre pour ouvrir l'article sur le média original.
Au matin du 27 avril 1986, des chars de l’armée soviétique entrent dans la petite ville de Prypiat, en Ukraine. Ils sont suivis par 1.225 autocars. Les habitants doivent être évacués en urgence. Il est déjà trop tard: cela fait près de trente heures que le réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl a explosé. Prypiat, qui se trouve à trois kilomètres au nord de Tchernobyl, abrite des milliers de travailleurs de la centrale nucléaire. La veille, leurs enfants sont allés à l’école comme si de rien n’était. Tous ont reçu, sans douleur ni conscience, des doses de radiation qui dépassent l’entendement. La population, tenue au courant grâce à la radio locale, se voit donner l’ordre de prendre le strict minimum et de quitter les lieux au plus vite. Les autorités promettent qu’ils pourront revenir d’ici deux ou trois jours. Ils ne reviendront jamais.
Prypiat fait aujourd’hui partie de «la Zone». Sur une trentaine de kilomètres, des villages fantômes peuplent ainsi la zone d’exclusion de Tchernobyl. De la plus grande catastrophe environnementale jamais connue à ce jour, il ne reste plus aucune activité humaine. L’Homo sapiens a disparu. Des pygargues à queue blanche, des cerfs, des chevaux sauvages et des loups gris se promènent désormais dans les rues et les forêts du coin. La Zone d’exclusion de Tchernobyl fait partie aujourd’hui de la liste des parcs involontaires.
Le terme de «parc involontaire» aurait été inventé par l’auteur écologiste et rétrofuturiste Bruce Sterling. Dans ses notes consignées sur le site viridiandesign.com (le viridien est un vert bleuté), Sterling explique que «les parcs involontaires sont très viridiens. Ils ne représentent pas la nature vierge mais la nature vengeresse et l’ensemble de ses procédés, qui réaffirment leur présence dans des lieux de perdition politique et technologique».
DMZ et ligne verte
23 mars 1953. Staline est mort voilà quinze jours. Sur la route du village de Panmunjeom, le général nord-coréen Nam II, le maréchal chinois Peng Dehuai et le lieutenant-général William K. Harrison des Nations unies se retrouvent pour signer l’armistice entre les deux Corées. Une zone démilitarisée de 246 kilomètres de long et 4 kilomètres de large est établie au milieu de la péninsule. Appelée communément DMZ, elle sert de zone tampon entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et marque la frontière entre les deux pays. Aucun humain, qu’il soit coréen ou touriste, n’est habilité à y pénétrer.
Des grues du Japon, classées dans la liste des espèces en voie de disparition, tout comme des grues à cou blanc, sont aperçues volant au-dessus de la zone. Rapidement –dès les années 1950– des biologistes sont appelés pour observer les animaux se promenant le long du 38e parallèle. Ils découvrent que l’endroit abrite également des tigres de Sibérie, qui font partie des 100 espèces les plus menacées au monde selon l’UICN, ou encore des gorals à longue queue et des ours noirs.
L’histoire se répète à Chypre, sur la ligne verte scindant le territoire contrôlé par la Turquie d’une part, et la République de Chypre d’autre part. Les îles Monte Bello, au nord est du continent australien, seraient semble-t-il un autre exemple de parc involontaire suite aux essais nucléaires opérés dans la région entre 1953 et 1957.
Post-apocalypse now
Gaël Barreau, écologue et naturaliste à l’association Terre & Océan, précise: «On parlera de renaturation spontanée. Sans aller aussi loin dans les exemples que Tchernobyl ou la DMZ, on trouve dans nos villes des exemples de ces parcs involontaires, dont sont d’ailleurs friands les fans d’Urbex (les carrières, les casernes militaires abandonnées etc.). Sur la Garonne, par exemple, il y a une ancienne île de l’Inra qui est devenue méconnaissable moins de dix ans après l’abandon de l’activité agricole. L’institut de recherche, pas manchot à l’heure de faire des vergers tirés au cordeau, a laissé place à d’épaisses frondaisons de frênes et de saules, et des loutres s’y baladent tranquillement au milieu des colonies de hérons et de cormorans. […]
Une simple route dans une forêt, dès lors qu’elle ne sera plus empruntée, disparaîtra au bout de quelques années (dans l’entre deux mers le village de Citon, abandonné dans les années 1970, n’a plus de route d’accès goudronnée reconnaissable car elle a été recouverte par la végétation en taillis). Les images que l’on peut voir dans les films hollywoodiens post-apocalyptiques ne sont pas loin du compte. L’histoire prouve que la nature peut engloutir des villes entières (les cités Aztèques ou encore Angkhor par exemple), mais un simple lotissement abandonné pendant quarante ans finit par disparaître de la même manière.»
La fascination de l'homme urbain
Une question reste en suspens. Comment les animaux pressentent leur destination? Comment savent-ils où aller? Si aucune étude n’a été trouvée, il semblerait que cela dépende d’un ensemble de facteurs, différents selon les espèces, à la manière des flux migratoires. Quant à l’aspect technique, il faut lorgner du côté des corridors biologiques qui peuvent permettre l’existence des parcs involontaires.
Ce serait une erreur, toutefois, de regarder les parcs involontaires avec des yeux candides. La qualification à elle seule soulève quelques problématiques. Car involontaire pour qui, sinon pour l’homme?
L’écologue bordelais Gaël Barreau admet que «[Le phénomène des parcs involontaires] dit également la fascination de l’homme, aujourd’hui essentiellement urbain, de ce retour spontané à la nature. Mais cela fascine parce que l’on n’est pas là pour le subir. On s’émerveille de voir ces loups dans une zone contaminée, mais on s’émeut d’un sanglier dans les rues de Toulouse, parce qu’il n’y est pas à sa place. La relation de l’homme à la nature est à ce prix: elle est belle quand on ne la subit pas malgré soi, d’où notre aversion pour les espèces liminaires, celles qui ont su profiter de nos largesses à l’image des pigeons, araignées des maisons ou des rats, complètement adaptées à vivre auprès de nous mais toujours farouchement sauvages.» Un point de vue partagé par Philippe Reigné, agrégé de droit, qui écrivait en décembre 2016 une tribune à ce sujet dans le journal Libération.
Un fait naturel
De la même façon, ces zones vertes ne sont peut-être pas non plus des «paradis pour animaux» comme elles sont parfois décrites. Les mines qui peuplent la DMZ, tout comme les radiations encore contenues dans les sols de la zone de Tchernobyl, ont potentiellement des incidences sur le bien-être et la reproduction des animaux. En 2008, plusieurs chercheurs ont dénoncé les croyances entourant la faune et la flore de Tchernobyl et ce alors même qu’aucune étude ni statistique n’avaient été dûment réalisées.
Nul doute que les parcs involontaires, aussi réels qu’ils soient, nourrissent notre désir de magie. Quoi de plus merveilleux que la nature sauvage, la beauté infinie des plaines et la liberté au grand air? En réalité, comme l’explique Gaël Barreau:
«Dès que [l’homme] relâche son emprise, les êtres vivants recolonisent rapidement le milieu. Le cas de ces zones sanctuarisées obéissent à un même phénomène: des espaces d'occupation jadis humaine laissés à la nature, et donc occupée de nouveau par les êtres vivants.»
Pas de sortilège, ni d’enchantement. Rien qu’un fait naturel.
«Abandonnez la tondeuse de temps en temps, et malgré les plaintes des voisins, c’est la garantie de voir apparaître au bout de quelques années des orchidées sauvages. Et un abandon définitif sonnera l’arrivée à terme d’une forêt. Les enjeux écologiques d’aujourd’hui sont certes sur des grands ensembles à conserver, comme les forêts tropicales et autres zones de toundra, mais la reconquête par les petites surfaces contigües, en plus de demander peu d’efforts, est un facteur qui peut amener cette notion de parcs involontaires au cœur de chaque jardin.»
Alors, voilà le plus merveilleux de l’histoire des parcs involontaires: d’une certaine manière, il ne s’agit pas d’un miracle qui nous dépasserait. Nous pouvons nous-mêmes insuffler cette magie dans notre quotidien.
«Tu fais quoi cet été ? » « Je vais au camping dans le Sud. » Voilà une conversation qui se comprend mais qui ne dit, finalement, rien de la destination. Autre exemple : « Tu habites où ? » « Dans le Sud. »
Pour l’essentiel, nous aurons compris par « Sud » le « sud de la France », soit un vaste espace géographique qui pourrait aller de Nice à Perpignan. Le pourtour méditerranéen, en gros. Mais d’autres acceptent une définition plus restrictive du sud de la France, à commencer par les Provençaux : « A partir de Montpellier - Nîmes c’est déjà le Sud-Ouest. Après Montélimar, on est déjà plus dans le Sud », résume Fabien, bientôt 40 ans et une vie passée entre Arles et Marseille.
« La guerre des Suds » n’aura pas lieu
Géographiquement pourtant, le Sud n’est pas autre chose qu’une « manière de s’orienter dans le monde, une valeur cardinale, l’inverse du Nord », explique à 20 Minutes la géographe Marie-Alix Molinié-Andlauer, pour qui la notion « d’espace sud en France est une acceptation sociale qui n’est pas une entité administrative reconnue ».
Ce n’est pas faute pour certains d’avoir essayé : voilà près d’une dizaine d’années que Renaud Muselier, le président de la région PACA, utilise dans ses communiqués et prise de parole le terme de « Région Sud », sans que cela n’ait d’existence administrative. Et ce alors que le terme « Sud de France » a été déposé à l’INPI depuis 2006 par la région Languedoc - puis Occitanie - pour commercialiser des produits du terroir.
Mais « la guerre des Suds » n’aura pas lieu. « D’abord parce que la notion de Sud en France connaît plusieurs acceptations, reprend la géographe Marie-Alix Molinié-Andlauer. Ça peut être ce qui est au sud de la Loire, ou bien un plus bas sur une ligne Limoges-Lyon ». Il arrive aussi que l’on cite le 45e parallèle, marquant l’équidistance entre l’équateur et le pôle Nord. Il passe par la Drôme selon une ligne Lacanau - Briançon.
Nous voilà guère plus avancés sur cette définition du « Sud de la France », d’abord affaire « d’espace vécu et de ses échelles de déplacements. Demandez à un Parisien ce qu’est le “Sud”, à un Limougeaud, à un Lyonnais : vous allez avoir des réponses relativement différentes », poursuit Marie-Alix Molinié-Andlauer.
L’influence du Mistral
Au titre « des échelles de déplacements », comment ne pas songer aux vacances et à la bien nommée « Autoroutes du sud de la France (ASF) », du nom de la société en charge d’exploiter ce réseau. Avec ces mots, Vinci mobilise tout un imaginaire : l’autoroute est une entrée vers le sud, le soleil, la mer et un style de vie. Il existe même une œuvre d’art à cet effet : sur l’aire d’autoroute de Savasse, juste au nord de Montélimar, se trouve une sculpture figurant la « Porte du soleil ».
Cette localisation, le météorologue Paul Marquis ne la trouve pas inconsidérée : « Techniquement, à partir de Valence-Montélimar, le climat change sous l’effet du Mistral, qui protège le Sud-Est des nuages et des intempéries. C’est pour ça qu’en situation classique, on peut avoir des nuages et de la pluie du côté des Lyonnais et du nord de la France, et que dès qu’on passe Montélimar, ils sont dissipés par le vent ».
Dans le Sud-Ouest, « la Tramontane peut jouer un peu le même rôle », explique le météorologue. Pour qui il « existe vraiment deux régions dans le Sud et beaucoup de climats différents : un climat méditerranéen du sud-est, un autre du sud-ouest, un climat océanique comme à Biarritz et un climat plus montagnard, alpin, dans les Hautes-Alpes ».
Langue d’Oc, langue d’Oï
Pour le linguiste et marseillologue Médéric Gasquet-Cyrus, la notion de « Sud de la France » se rapporte d’abord à une « une identité sudiste » qui défend (avec humour et chauvinisme) son près carré géographique. Et comme toute identité, elle se construit d’abord sur l’exclusion, la définition d’abord de ce qui n’est pas : « Cela fait un siècle qu’il existe des blagues sur des gens qui se revendiquent du Sud, genre les Lyonnais, que Marseille regarde en mode : “juste non”. Car indépendamment de la position géographique, le « Sud » renvoie à un imaginaire, un mode de vie : soleil, calanques, plages et pastis », résume le linguiste.
Mais il n’en a pas toujours été ainsi. « On a longtemps parlé du “Midi de la France”, et cela a été négativement connoté. Les gens du Midi étaient perçus comme feignants, violents, le sang bouillant sous l’effet du soleil. Il y a toute une littérature du XIXᵉ siècle à ce sujet. Ensuite, il y a l’apparition de la Côte d’Azur. Et ce “Côte d’Azur” permet de bien baliser, de définir, pour nous Provençaux, un côté qui n’est pas “notre Sud à nous”. Il y aurait donc le Midi à l’ouest de la Camargue, la Côte d’Azur à l’est, et entre les deux, nous, le Sud », tranche Médéric Gasquet-Cyrus. Toujours dans cette quête du Sud, il peut aussi accepter une définition linguistique basée sur la langue d’Oc et la langue d’Oï, qui ont longtemps divisé la France selon une ligne Limoges-Lyon.
La France ne fait pas exception
Où est le Nord ? Le Sud ? La distinction reste donc subjective et traverse d’autres pays : « En Italie, il y a une distinction Nord/Sud très forte. En Espagne aussi. Mais il est très compliqué de les comparer avec la France, car ce sont des pays très régionalisés », observe la géographe Marie-Alix Molinié-Andlauer.
« En Italie, le Sud est connoté très négativement. Ce sont les pouilleux (de la région des Pouilles), quasiment pas des Italiens », complète Médéric Gasquet-Cyrus. Une stigmatisation géographique et une forme de ségrégation économique qui traverse aussi Marseille, mais à l’envers : les quartiers Nord, pauvres, s’opposent aux plus aisés du sud de la ville. « Tout reste une histoire de point de vue », conclut le linguiste avec cette expression tirée du groupe « Fracas », formé à Montpellier : « Le fracas vient du sud de France, mais là-bas on dit nord de Méditerranée ». Car même tout au Sud, on reste au nord de quelqu’un d’autre.
par Jean-Marc Proust – 27 septembre 2025
Dans quelques semaines, l'Académie suédoise décernera le prix Nobel de littérature de l'année 2025, en parallèle des quatre autres récompenses, décernées depuis 1901. Conformément aux vœux d'Alfred Nobel, les prix Nobel honorent «chaque année des personnes qui auront rendu de grands services à l'humanité, permettant une amélioration ou un progrès considérable dans le domaine des savoirs et de la culture dans cinq disciplines différentes: paix ou diplomatie, littérature, chimie, physiologie ou médecine et physique».
Tentons un pas chassé dans ce ballet cérémoniel en suggérant que le prochain lauréat du prix Nobel de littérature soit Wikipédia. Oui, Wikipédia, cette libre encyclopédie en ligne que nous consultons pour vérifier un truc, trouver un texte classique, découvrir la guerre du Péloponnèse (Ve siècle avant J.-C.) ou le crapaud nain de Kandy… Ou contribuer en corrigeant une coquille, en ajoutant deux ou trois lignes, un paragraphe voire en créant une page.
Conformité au «puissant idéal» d'Alfred Nobel
Est-ce saugrenu? Absolument pas. Tout d'abord, observons que l'encyclopédie en ligne –partage (inédit par son ampleur) universel des savoirs– répond aux exigences testamentaires d'Alfred Nobel en ayant «fait la preuve d'un puissant idéal». S'y ajoute une foi extraordinaire dans les capacités des humains à créer ensemble ces savoirs, les exposer, les discuter, les améliorer, de la simple contribution à l'exigence la plus savante.
En donnant un accès simple et immédiat à un champ de connaissances universel, cette encyclopédie prend aussi le parti de la lecture dans un monde où elle semble devoir inexorablement se marginaliser. Et d'une lecture exigeante: certains articles sont incroyablement fouillés, regorgeant d'érudition, de détails et de références. Une manière de savants bras d'honneur aux vidéos de quelques secondes, oubliées peu après avoir été publiées. À cet égard, Wikipédia porte là une vision politique. Comme des pans entiers de la littérature.
En ligne avec le «puissant idéal» du fondateur, le comité Nobel surprend parfois avec des choix inattendus (Bob Dylan en 2016) et, plus souvent, politiques. Plusieurs écrivains s'opposant à des régimes autoritaires ont ainsi été distingués: le Soviétique Alexandre Soljenitsyne (1970), le Chilien Pablo Neruda (1971), le Français d'origine chinoise Gao Xingjian (2000)… Là encore, ce critère s'applique largement à Wikipédia, plusieurs fois victime de censure et de blocages par des régimes autoritaires (Biélorussie, Chine, Iran, Russie, Syrie, etc.) et quelques démocraties (France, Italie, etc.), honte à elles.
Cette exigence politique est d'autant plus nécessaire que Wikipédia est désormais menacée par les «progrès» de l'intelligence artificielle. Ainsi, dans les recherches Google, des résumés «maison» sont désormais mis en avant, pillant allègrement les ressources gratuites de l'encyclopédie en ligne. L'élève qui pompait tranquillement Wikipédia demande désormais à ChatGPT de le faire à sa place. Ces clics disparus détruisent progressivement la visibilité de l'encyclopédie, réduisent son nombre de visiteurs, menaçant indirectement ses financements (versez quelques euros après avoir lu cet article).
Un projet universel et profondément littéraire
Par ailleurs et même si cela n'apparaît pas de prime abord, le projet de l'encyclopédie en ligne est éminemment littéraire. Il en recouvre de nombreuses formes: synthèse et analyse mais aussi récit, poésie, cadavre exquis, brouillon…
En effet, Wikipédia est d'abord une page blanche. Que l'inspiration soit là ou non, tout y est à construire. Écrire un premier jet, aligner des paragraphes, identifier des références, soigner son style, insérer des citations, synthétiser sa pensée… Soudain, votre travail est repris et amélioré, parfois réduit ou détruit. Ici, on insère une précision. Là, on supprime une phrase hasardeuse. Ailleurs, c'est tout un développement qui s'impose. Chaque clic y est une inspiration ou une rature. Ratures dont l'historique est soigneusement conservé: quelle mémoire, quel «manuscrit»!
Cette écriture à quatre mains (baptisons-la ainsi quoique le nombre de doigts wikipédiens soit incommensurable) est connue. Pierre Souvestre et Marcel Allain écrivirent ainsi la série Fantômas. Sous les romans d'amour de Delly se cachaient Jeanne-Marie Petitjean de La Rosière et son frère Frédéric. Songeons aussi aux frères Goncourt.
Écrire à plusieurs? Il y a également là une proximité avec les cadavres exquis, à cette nuance près que le jeu créé par les écrivains surréalistes prévoyait que chaque contribution se fasse en ignorant la précédente. Dans Wikipédia, il suffit parfois d'un peu de mauvaise foi pour qu'il en soit ainsi…
Écrire sous pseudonyme? Mais c'est toute l'histoire de la littérature qu'il faut ici convoquer. Voltaire! George Sand! George Orwell! Lewis Caroll! Trevanian! Vercors! Émile Ajar! Il arrive probablement à des célébrités de jouir de l'anonymat que permet internet pour contribuer à l'encyclopédie et pas seulement pour rectifier la page qui les concerne.
Voici donc qu'en un quart de siècle a surgi une écriture universelle et, loin de la sacralisation du «grand écrivain», démocratique: toute contribution est bienvenue, pour peu qu'elle se conforme à quelques règles simples. Wikipédia met l'écriture à la portée de tout le monde.
La comparaison s'impose avec une autre encyclopédie, celle –éponyme– de Diderot et D'Alembert, splendide modèle d'écriture collaborative. On compte alors quelque 158 contributeurs à cette œuvre immense, la plupart anonymes. Ce modèle, Wikipédia l'a amplifié: des contributeurs par centaines de milliers, à l'échelle mondiale, pour produire le plus grand défi littéraire de notre temps.
Traductions, hypertexte et canulars
Comme ce fut déjà le cas au XVIIIe siècle, Wikipédia s'est enrichie et développée progressivement, grâce notamment à de nombreuses traductions. Articles en anglais au départ, traduits et synthétisés, aujourd'hui presque tous disponibles dans une dizaine de langues. Wikipédia nous rappelle chaque jour l'importance du métier de traducteur, sans lequel des pans entiers de la littérature nous seraient inconnus. Et l'on félicitera au passage les correcteurs, toujours prompts à améliorer un article par des contributions discrètes quoique essentielles.
Autre développement ô combien littéraire: dans Wikipédia, grâce à l'hypertexte, chaque article est relié à d'autres articles, existants ou à créer, à la manière de récits enchâssés ou d'un inépuisable roman à tiroirs. Ou, pour être plus moderne, un magnifique bric-à-brac de préquels et séquels, aux ramifications toujours plus vastes.
Parfois, un canular surgit, démasqué plus ou moins rapidement, éventuellement archivé. Dans une terminologie toute situationniste, il est assimilé à du «vandalisme sournois». La littérature en a connu plusieurs: Jean du Chas et Le Concentrisme (merci Samuel Beckett) ou Bilitis (bravo Pierre Louÿs) et l'on n'oublie pas le merveilleux Jean-Baptiste Botul. Oui, les trolls aussi appartiennent au projet littéraire.
Guerres d'édition et neutralité du texte
Enfin, par ses foires d'empoigne feutrées entre contributeurs plus ou moins aguerris, Wikipédia relève évidemment du salon littéraire comme de la querelle des Anciens et des Modernes, à grands renforts de rhétorique, de théâtre et de mauvaise foi.
Ces conflits doivent autant à la sensibilité de certains sujets qu'à l'actualité. Car Wikipédia est la première expérience littéraire d'écriture globale en temps réel, qui flirte avec le journalisme, mais s'en distingue en captant l'essentiel (ce qui restera). Pour ma part, je suis toujours fasciné de constater qu'un trophée sportif ou un décès sont immédiatement intégrés à l'encyclopédie en ligne. Et aussitôt vérifiés, voire contestés.
Le comité Nobel pourrait aussi récompenser Wikipédia pour son extraordinaire productivité, puisque l'encyclopédie a produit 7,1 millions d'articles en un quart de siècle et est accessible en 342 langues.
Car existe-t-il un autre endroit au monde où un paragraphe, une phrase, parfois un mot suscitent autant de débats? Il s'agit de trouver la forme parfaite, une gageure évidemment mais qui mobilise d'interminables échanges. Et il y a là un débat à l'horizontale au sein duquel personne ne peut se prévaloir d'une quelconque supériorité intellectuelle.
L'exigence encyclopédique s'exprime ici en espérant dégager un point de vue neutre (le «style Wikipédia»?). Impossible défi? Ce faisant, elle n'échappe pas aux nombreux débats relatifs au langage et à sa violence, à sa manière de traduire l'oppression ou l'émancipation. «C'est dans le mot que nous pensons», disait le philosophe allemand Georg Hegel (1770-1831, merci Wiki). En s'efforçant de trouver un langage commun (plutôt que neutre) pour s'écouter et se comprendre, en préférant l'argumentation à l'autorité, Wikipédia nous offre chaque jour une grande leçon de composition littéraire.
La valeur n'attend pas le nombre des années
Créée en janvier 2001, Wikipédia aura bientôt 25 ans. À la fois la prime jeunesse et la préhistoire pour internet. Le comité Nobel pourrait aussi récompenser l'encyclopédie en ligne pour son extraordinaire productivité, puisqu'elle a produit 7,1 millions d'articles en près d'un quart de siècle et est accessible en 342 langues (source: Wikipédia, bien sûr).
Un trésor universel, que même les encyclopédistes des Lumières n'auraient pu concevoir. Un trésor que nous consultons régulièrement sans en mesurer l'importance, tant il est entré dans nos pratiques et notre patrimoine culturel. Nous n'en mesurons pas assez l'importance au moment où l'intelligence artificielle et ses divers usages nous abreuvent d'approximations et de mensonges, jungle numérique dans laquelle nous naviguons –aveugles– à vue.
Accessoirement, les 10 millions de couronnes suédoises (près de 910.000 euros) allouées au lauréat par l'Académie suédoise seraient bienvenues pour la Fondation Wikimedia, qui finance le projet et en garantit l'indépendance. Alors oui, donnons le prix Nobel de littérature à ce «puissant idéal» qu'est Wikipédia!
P.-S.: Et dès que ce sera acquis, ouvrons une page Wikipédia pour écrire collectivement le discours de réception du prix à Stockholm.
C'est un incontournable de l'été et des vacances. La carte postale est là, à la vue de tous, apposée sur des tourniquets de magasins de plage ou dans des boutiques éphémères quelque peu bobos. Souvent kitsch, tournée vers le passé, ou floquée d'un design plus moderne, la carte postale semble traverser les âges… Depuis combien de temps exactement?

Derrière son allure quelque peu désuète, ces bouts de carton ont en fait une histoire riche, marquée par un début timide et controversé, avant de connaître un succès tonitruant, notamment grâce à un événement qui marquera l'histoire. Une success story à laquelle les modes de communication modernes ont mis un sacré plomb dans l'aile, sans pour autant les faire disparaître.
D'une blague à un concept révolutionnaire
Qui a inventé la carte postale? La question reste entourée de mystère, tant un nombre incalculable de pays européens revendiquent sa paternité. Si l'on s'envoie des lettres depuis l'Antiquité, la carte postale, qui se différencie par son côté recto illustré et s'envoie sans enveloppe, aurait fait ses premiers pas au milieu du XIXe siècle, par le biais d'un certain Theodore Hook.
Ce Britannique, dramaturge et romancier (en plus d'être un sacré rigolo), envoie en 1840 une drôle de «lettre»: un bout de carton, sans enveloppe, muni d'un timbre et coloriée à la main, représentant un dessin tournant en dérision les employés de poste. Le destinataire? Lui-même.
Après ce prototype expérimental et visiblement moqueur, vient le temps de la structuration du concept. En 1865, une conférence postale austro-allemande marque un tournant. La carte postale est alors officiellement pensée et son concept approuvé. À peine quatre ans plus tard, en Autriche, un professeur d'économie, Emanuel Herrmann, apporte un coup de pouce décisif au modèle. Il propose une carte de correspondance à bas coût et sans enveloppe. La carte postale est née.
En bon râleur, le scepticisme franchouillard est de mise face à ce nouveau concept venu de l'Est, où son utilisation explose. Trop intrusive, elle expose les écrits du destinataire au tout-venant –notamment aux petits personnels– et l'intimité des messages se retrouve dévoilée au grand jour. Il faut attendre quelques années encore pour que la correspondance à découvert soit finalement autorisée en France… notamment grâce à la guerre franco-allemande de 1870-1871.
Âge d'or timbré
En plein conflit entre la France et la Prusse, un événement va marquer l'arrivée en force de la carte postale dans les mœurs de l'Hexagone: le siège de Strasbourg de 1870. La Société de secours aux blessés fait circuler un carton estampillé de la Croix-Rouge, permettant aux soldats français de rassurer leurs familles, sans nouvelles de leurs hommes encerclés. Cette initiative, autorisée par les Allemands, marque une première utilisation massive en France de ce nouveau moyen de communication. Deux ans plus tard, son utilisation est officiellement autorisée.
En un rien de temps, la carte postale gagne du terrain. Moins chère et plus rapide que la lettre, c'est une alternative efficace dans un monde où le système postal est encore en plein essor. À l'aube du XXe siècle, ces petits bouts de carton sont carrément à la mode et on se les arrache. Preuve en est avec la première carte illustrée française représentant la tour Eiffel, datant de 1889. Son éditeur, Libonis, en vendra pas moins de 57.500 exemplaires en vingt jours, un record pour l'époque.
La carte postale mania prend un autre tournant après 1890, quand un Marseillais du nom de Dominique Piazza envoie une carte bien particulière à un ami argentin. Sa spécificité? C'est en fait une photographie de la cité phocéenne, collée sur du carton. Très vite, le concept (que Dominique Piazza n'a pas déposé, coup dur pour lui) explose. On illustre tout: les paysages, les événements historiques, les scènes du quotidien… et les chats.
On est alors dans ce qui pourrait ressembler au tout premier réseau social de l'histoire, à cheval entre Facebook et Instagram. Les messages sont courts, lisibles par tous, documentent la société, relaient parfois de la propagande, font rire, s'exposent, se collectionnent. Et l'on s'arrache les illustrations improbables qui les accompagnent, de véritables mèmes viraux, que l'on s'empresse de partager. Un véritable âge d'or.
Zappée comme jamais?
On y ajoute de la couleur dans les années 1950, on y intègre des microsillons dans les années 1960 pour qu'elle fasse de la musique (un flop), on change la forme, les illustrations (qui prennent souvent une tournure sexiste)… Bref, la carte postale passe par tous les états. Jusqu'à sa chute?
Ce n'est un secret pour personne: l'âge d'or de la carte postale est passé et son déclin est amorcé depuis bien longtemps. Depuis l'arrivée du téléphone, dès les années 1945, même. Les mails, les SMS, les réseaux sociaux mettent à chaque fois un peu plus à mal ces petits bouts de carton, devenus presque obsolètes.
Faut-il pour autant enterrer définitivement la carte postale? Pas tout à fait. Chaque année, encore 74 millions d'entre elles sont envoyées en France. Si cette dernière a quelque peu perdu son pouvoir de correspondance, elle s'est transformée en un symbole d'une attention personnalisée et particulière.
Ce n'est plus tant le contenu, mais le fait de l'avoir envoyée qui compte, dans un monde où l'instantanéité des messages éphémères estompe les preuves d'amour et d'amitié. Un geste symbolique qui marque un souvenir tangible, qu'aucun autre moyen de communication, aussi moderne soit-il, ne permet. La carte postale est morte, vive la carte postale!
L’histoire fabulée de l’iris revestois
Une uchronie imaginée par le Comité d’invention de l’Iris Bleu du Revest (IBR)
 Les iris de Van Gogh
Les iris de Van Gogh
L’histoire ne se raconte pas, elle s’écrit.
L'Histoire avec une majuscule est toujours sujette à caution car vecteur de propagande des gens de pouvoir et des influenceurs. Et la petite histoire, celle du quotidien, celle dont se nourrissent les sociétés d’histoire locale, c’est bien pareil aussi. Le filtre humain travestit la vérité qui ne sera jamais qu'un mirage qu'on n'atteindra jamais. Pas plus que la grande Histoire, l’histoire locale ne peut être une science exacte. La vérité historique n’existe pas, elle se construit, elle s’invente. Si tant est que l’histoire puisse être une science, ce sera une science de la communication.
Les Romains au Revest
En 50 avant J.C., des commerçants Romains découvrent Le Revest, capitale du peuple Comoni. Ces industrieux Celto-Ligures cultivent une plante qui lors de la empereur romain avec toge bleuefloraison, originale car hivernale, couvre de bleu les collines du pays. Les indigènes en tirent dans leurs ateliers tinctoriaux un colorant végétal bio et naturel selon un procédé confidentiel, original et copyrighté qu’ils refusent de communiquer. Aux teintureries sont adjointes des activités de filature et de tissage qui font de la vallée de Dardennes, au début de notre ère, un petit centre industriel à la renommée régionale. Les Romains, pendant quelques décennies, en sont réduits à troquer uniquement les étoffes déjà teintes de ce bleu intense, nommé plus tard par les peintres « bleu revestois », que les Comoni commercialisent déjà de Nikaïa à Massilia.
Plus bleu que le bleu de tes yeux
Une petite précision : on nous a maintes fois seriné que l’industrie tinctoriale de la pourpre, réservée aux empereurs romains, était à l’origine de la fondation de Toulon, avec sa teinturerie à l’embouchure du Las, son eau si pure et si abondante à la source Saint-Antoine, dédiée alors au Dieu Telo,et tutti-quanti, vous connaissez l’histoire. Enfin, on vous a raconté l’histoire. Car le truc du murex, c’était du pipeau : on n’en a jamais retrouvé dans cette partie de la Méditerranée. Garanti sur facture : absolument aucune trace à Toulon de murex mort ou vif. Et pour cause ! La couleur bleue était inconnue de l'humanité au moins jusqu'à l'Antiquité. En effet, le mot bleu n'est pas retrouvé dans les langues et textes anciens, sauf dans la civilisation égyptienne. On ignore s'il s'agit de daltonisme ou simplement d'une absence de sensibilité à cette couleur, peu présente dans l'environnement humain de l'époque. Ce que les Romains appellent « Pourpre » et réservent en un premier temps à leurs empereurs et assimilés, c’est le bleu revestois.
Les dirigeants romains, en particulier les empereurs qui se succèdent à la vitesse grand V, commencent à s’intéresser sérieux aux étoffes bleues du Revest. Ils exigent de maîtriser toute la chaîne de fabrication par une intégration verticale de toutes les activités, depuis la culture des iris jusqu’à la merchandisation des étoffes et des vêtements en prêt-à-porter.
Ils essaient d’abord de neutraliser les terminaux de vente à Nikaïa, Olbia et Massilia. Mais si les Romains étaient bons commerçants, ça se saurait. Échec sur toute la ligne. Ils tentent alors de couper les axes de communication en bloquant les ports. Sauf qu’ils ne sont pas bons marins et leur filet laisse passer les pirogues de livraison qui parviennent toujours à destination.
La guerre des deux pourpres
Dorénavant, une seule option s'offre à l’empereur Romain pour s’approprier l’iris bleu du Revest : la guerre terrestre. Ah ! Ma qué voilà enfin une discipline où les Romains sont les maîtres. C’est ce qu’on appelera La Guerre éclair des Deux Pourpres. (On rappelle que les Romains étaient génétiquement Daltoniens). Un matin de septembre, près avoir suivi l’A8 (la via Aurelia, qu’ils disaient) en provenance de Cimiez, l’armée romaine vire plein Sud à Turris (aujourd’hui, Tourves), et empruntant les drailles des sambles que prendront l’armée de Grignan en 1707 puis les Turcos en 1944, ils déboulent en haut de la carrière et s’emparent du Revest. Classique.
Après avoir vainement essayé d’extorquer les secrets de fabrication aux maîtres teinturiers Comoni, les Romains, qui causaient pas beaucoup estranger, se résolvent à arracher les rhizomes d’iris des collines revestoises dans l’objectif de les replanter chez eux, dans un territoire où ils pourront les étudier en détail et les exploiter loin de ces terres tumultueuses des Comoni. Et ce qu’ils ne pourront transporter vers leurs péniches qui attendent au port, ils le brûlent, oui oui oui, ils mettent le feu aux collines. Sauf que ça prend pas beaucoup, parce que en ce temps-là, toutes les terres étaient bien entretenues, désherbées, débroussaillées.
Et c’est ainsi qu’Octave qui se faisait appeler Auguste, tout content d’avoir raflé 3 barquettes d’iris aux Comoni, fit inscrire le nom de cette tribu sur la liste des peuples vaincus au Trophée de La Turbie. En -6 av. J.C.
Bon, maintenant, vous savez.
Le culte marial et le bleu de Marie
On n’entend plus beaucoup causer des Comoni pendant un bout, ils ont juste continué à vivre tranquilou dans leurs collines, tout habillés de bleu, sans trop s’occuper des autres. Avec de temps en temps un regain d’intérêt, comme vers le Ve siècle de notre ère, pour les teintures bleues de Revest.
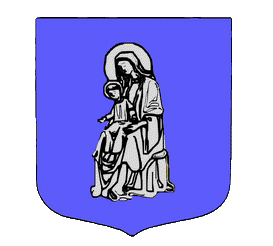 Blason marial
Blason marial
Connaissez-vous Notre-Dame de Pépiole, non loin du Revest, au pied de la colline de Six-Fours ? Dès l’origine, cette chapelle dépend de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille. L’abbaye a été fondée vers 416 par saint Jean Cassien. Or, Cassien a beaucoup voyagé en Orient : Bethléem, Constantinople, Alexandrie. De ses séjours dans les monastères égyptiens du désert, il a rapporté les principes des institutions monacales. C’est lui l’inspirateur de la liturgie gallicane, d’origine orientale qui s’opposait à la romaine. Si l’on y ajoute que le concile d’Ephèse en 430 se détermine sur la nature de la Vierge et initie le culte de Marie, on rejoint l’affirmation de grands voyageurs : Notre-Dame de Pépiole est la réplique de la chapelle de la Vierge d’Ephèse, ville où Marie est née et aurait fini ses jours.
Cassien avait aussi rapporté d’Orient un modèle architectural et l’invention du culte marial en Occident : Pépiole y serait la première église dédiée à la Vierge. Et elle se situe à 3 encâblures des teinturiers Comoni. La conclusion est évidente : le bleu de Marie qui va équiper toutes les églises de la chrétienté est d’origine revestoise, c’est le « bleu revestois » des iris de nos collines.
Et les Sarrasins dans toussa ?
Là, nous n’avons trouvé aucune preuve, mais nous allons faire comme tous les autres : les inventer. Nous pouvons amalgamer un certain nombre de coïncidences toutefois qui pourront appuyer notre démonstration.
- Comme la Tour du village est dite « Sarrasine » de par la tradition orale, on peut on déduire que ce sont les Sarrasins qui l’ont édifiée.
- Le bleu revestois est celui produit à partir de l’iris unguicularis des botanistes, que l’on appelle vulgairement aujourd’hui l’Iris d’Alger. C’est bien la preuve que les Sarrasins sont repartis chez eux après avoir razzié le pays, en dérobant notre trésor le plus précieux : ils ont surchargé leurs drakkars de rhizomes d’Iris Bleus du Revest et ont acclimaté le Végétal Revestois chez eux, là-bas, sur l’autre bord.
- Et puis surtout, vous avez déjà vu des photos des Hommes Bleus du désert : c’est aussi notre traditionnel habit bleu revestois qu’ils ont importé chez eux.
Ensuite, aux temps modernes, on peut tout imaginer. Même le grand Vincent dans notre village de peintres.
Alors, vous voyez bien, maintenant, qu’il existe une tradition revestoise quasi authentique de la culture de l’Iris Bleu.
Sources
Telo, Ragas, Foux ... (private joke)
Références
Vu qu’on y était pas, on peut pas garantir que ça s’est passé comme ça. Toutefois, d’autres historiens ont rapporté les mêmes faits, mais ils sont peut-être aussi affabulateurs que nous. Allez savoir …
- le nom de Toulon est dérivé du dieu des eaux Telo qui était honoré près de la source qu’on appelle Saint-Antoine. Selon André-Jean Tardy : De Telo à Amphitria
- les Romains ont créé un port à l’embouchure du Las
- et une teinturerie pour produire de la pourpre, même si on n’a pas trouvé ici de trace de murex (pas de coquilles anciennes ou récentes)
- Octave-Auguste s’est glorifié sur le trophée de la Turbie d’avoir vaincu le peuple Comoni qui devait se situer dans nos parages
- Cassien a fondé l’abbaye Saint-Victor dont dépendait Notre-Dame-de-Pépiole au moment où le concile d’Éphèse lançait le culte marial. Et Pépiole pourrait être la première chapelle d’Occident consacrée à Marie.
- Il n’y avait pas de mot pour « bleu » dans les langues antiques, on en a déduit qu’elle n’était pas perçue comme une couleur distincte par nos ancêtres.
Tout le reste de ce texte est pure invention. L’iris bleu n’a jamais été cultivé au Revest pour sa teinture. Aucune trace de Sarrasin dans notre histoire : on appelait sarrasine la herse qui fermait un pont-levis. Et selon ce qu’on en sait, Van Gogh n’a jamais mis les pieds au Revest.

